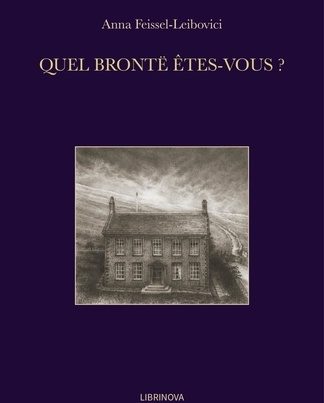Chère Anna, J’avoue, des Brontë, je ne connaissais que le nom et les sœurs, je veux parler du film d’André Téchiné, Les soeurs Brontë, avec Isabelle Adjani, Marie-France Pisier et Isabelle Huppert. Rendez-vous compte, je n’ai même pas lu Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre… On a parfois des trous dans une culture, et même des crevasses de montagne. Avec votre livre je découvre un monde, un univers étrange, celui de cette famille, les mœurs de cette famille qui ressemble à des Atrides anglais faits de brume et de lande… Pourriez-vous me raconter vos Brontë ? D’où vous vient cet intérêt et cette fascination pour cette famille ? Le fait de l’écriture ?

Cher Olivier, Ma propre culture n’est pas exempte de « crevasses », et si j’ai lu Jane Eyre très jeune et Les Hauts de Hurlevent à l’adolescence, jusqu’en 2007, j’ignorais tout de l’histoire de la famille Brontë, j’ignorais l’existence d’Anne, la troisième sœur, encore surnommée « l’autre », et même celle de Branwell. Cette année-là, j’ai ouvert la biographie de Branwell par Daphné du Maurier, à la recherche de précisions sur une scène dont j’avais entendu parler et qui aiguisait ma curiosité: un jour, le révérend Brontë réunit ses quatre enfants dans son bureau et s’amusa à leur poser des questions auxquelles il leur fallut successivement répondre en posant un masque sur leur visage. Les questions étaient plutôt édifiantes et les enfants surent répondre de façon à satisfaire leur père, sinon ce dernier n’aurait pas consigné leur dialogue. Le dispositif m’a fascinée.
Est-ce le regard et l’écoute de la psychanalyste que vous êtes ?
Je ne sais si c’est ma fibre psychanalytique qui a été touchée par cette tentative originale de délier la parole ou si j’aurais aimé avoir un tel père, héritier des princes philosophes et des recherches expérimentales du XVIIIe siècle, toujours est-il que le récit de cette scène si théâtrale m’a fascinée. Mais l’élément décisif a été de découvrir, grâce à cette même lecture, que les enfants Brontë avaient été des enfants écrivains. Qu’ils avaient couvert des dizaines de cahiers d’une écriture minuscule, indéchiffrable à l’œil nu, et que leur œuvre d’enfance était plus importante en nombre de pages que leur œuvre d’adultes. Qu’un certain Hatfield avait passé une partie de sa vie à la déchiffrer à la loupe… Ces quatre enfants, qui avaient perdu leur mère et leur deux sœurs aînées, et qui vivaient dans un village perdu dans la lande, ont imaginé un monde extrêmement élaboré, avec ses villes, ses institutions, ses intrigues politiques et amoureuses. C’est là qu’ils vivaient, dans « le monde du dessous ». Il se trouve que ma mère aurait beaucoup souhaité avoir une enfant écrivain, une sorte de Minou Drouet… De ce fait, les Brontë et moi, sommes instantanément devenus sisters and brother, et nous ne nous sommes plus quittés.
Les brothers et les sisters, Duras ? La pluie d’été ?
Oui, le corps historique de Marilyn, la beauté de Marilyn… à ce propos on dit que les sœurs Brontë n’étaient pas très belles, que pensez-vous du regard de Téchiné sur elles dans son film ?

C’est ce qui se disait et les quelques tableaux d’elles qui ont été réalisés, le fameux tableau « au pilier » de Branwell, comme celui de Charlotte par un grand maître, le confirment. Seule Anne avait grâce et joliesse ; Emily avait surtout de très beaux yeux, comme « liquides », et Charlotte avait bien conscience de son physique ingrat.

Je m’étais donc demandé à l’époque de la sortie du film de Téchiné, pourquoi il avait choisi trois actrices d’une beauté unanimement reconnue pour incarner les sisters. Était-ce pour lui garantir un minimum d’entrées dans les salles de cinéma, le thème du film ne s’adressant pas vraiment au grand public ? En découvrant la dernière série en date sur les sisters and brother, La Vie des sœurs Brontë de Sally Wainwright, j’ai compris qu’il ne suffisait pas de faire porter à Charlotte des bésicles sur un visage trop rond, ni de prêter à Emily des traits disgracieux pour mieux nous les faire connaître. Ce souci excessif de « vérité » nous empêche au contraire de rencontrer les sisters. Il m’a été plus facile de m’identifier à l’Emily de Téchiné, incarnée par Isabelle Adjani, celle qui apprend à tirer au pistolet avec son père et qui court sur la lande en pantalons d’homme. Quand on aime Emily Brontë comme une sister, on la trouve forcément belle ! Pour moi, ce film vaut largement ceux qui ont pu être réalisés par des Anglais, lesquels restent peu nombreux. Téchiné prend les jeunes Brontë au début de l’âge adulte, il ne montre rien de la frénétique activité d’écriture qui a débuté dans leur enfance, ce que j’ai pu regretter, vous le comprendrez, mais son film y gagne en force et en unité. Et s’il choisit trois femmes splendides pour incarner les sisters, il finit par s’intéresser surtout à Branwell, merveilleusement interprété par Pascal Grégory. Il n’y a pas à le lui reprocher, car c’est Branwell enfant qui a entraîné Charlotte d’abord, puis Emily et Anne, dans l’aventure de l’écriture collective. Il était le « moteur » du groupe, et semblait doué pour la peinture autant que pour la littérature, bref, il était l’espoir de la famille, un astre qui a, lui, décliné, et même sombré. Téchiné rend à Branwell ce qui appartient à Branwell, et c’est exactement ce que Daphné du Maurier avait voulu faire, réhabiliter le garçon.
Olivier Steiner, extrait du film Les soeurs Brontë, musique Tamino, Emile
Dans un meilleur monde, sans maladie, on aurait donc un immense écrivain dans le panthéon des lettres anglaises, Branwell ?
Dans un monde où la connaissance des névroses est plus avancée, on peut l’imaginer. Branwell était vraiment un garçon pétri de dons, qui faisait l’admiration de sa famille. Mais je me suis plutôt identifiée aux filles qui sont parvenues à devenir écrivaines, alors qu’elles ne s’étaient jamais longtemps éloignées de Haworth, autant dire, à l’époque, le bout du monde… Elles ont réussi, en dépit de tout ce qui s’opposait à leur désir dans cette époque victorienne, qui ne proposait pas d’autre idéal aux femmes que l’effacement. Voilà ce qu’elles représentent pour moi : parvenir à écrire contre vents adverses, et en trouvant comment faire jouer la voilure.
Pouvez-vous me parler de la vie de ces sisters, leur parcours comme une flèche lancée dans le monde ? Il y a ce passage chez Deleuze que j’adore, qui dit en gros que le génie c’est une flèche, elle est toujours là, au sol, puis un jour quelqu’un la prend et la lance dans telle direction… puis elle retombe, ça peut durer un siècle, et quelqu’un la trouve et la saisit pour la lancer à nouveau dans une direction nouvelle… je cite de mémoire.
Si les sisters ont eu du génie, je dirais que c’est le génie du lieu. Il leur a fallu tout trouver sur place, entre la bibliothèque de leur père, qui leur était largement ouverte, sans qu’il exerce la moindre censure, et la lande, espace sans limites. On ne trouve pas dans leur éducation les voyages de formation en France ou en Italie, qui ont tenu lieu d’expériences à la plupart des auteurs du XIXe siècle, au sortir de l’adolescence. La vie des Brontë dément l’idée bien ancrée selon laquelle il faudrait avoir « vécu » pour être capable d’écrire. Ou alors, elle nous amène à revoir ce qu’on entend communément par « vivre ».
Pour Emily, la lande fut son atelier ; elle en y façonna Heathcliff, son héros, dont le nom est un mélange de bruyères et de falaises. Et elle inventa une histoire d’amour immortel entre deux enfants, une histoire indissociable du paysage dans lequel elle se déroule.
Charlotte avait une méthode bien à elle pour suppléer à ce que la vie ne lui avait pas appris : elle fermait les yeux et tentait de l’imaginer aussi longtemps que nécessaire, après quoi elle l’écrivait. Elle commença Jane Eyre, dans la quasi obscurité qu’exigeait l’état de son père, tout juste opéré des yeux ; elle l’avait accompagné en tant que garde-malade dans une ville qu’elle ne connaissait pas et qu’elle ne chercha pas à connaître. Son manuscrit débutait justement ainsi : « Il ne fallait pas songer à sortir ce jour- là. »

Quant à Anne, elle ne voyait pas pourquoi recourir à l’imagination, quand elle avait tout ce qu’il fallait sous la main, la déchéance de son frère, par exemple, devenu dépendant de l’opium et de l’alcool. Elle écrivit La Recluse de Wildfell Hall, un roman encore mal connu du public, qui la révéla comme une vraie féministe avant la date.
Des météores qui continuent de graviter dans le ciel… Pourrait-on dire qu’Anne écrivait des sortes d’autofictions, tandis qu’Emily et Charlotte tiennent plus du naturalisme et d’Emily Dickinson ?
Aucune des sisters n’écrivait d’autofiction à proprement parler, pour elles le « moi » restait haïssable. Pour l’écriture d’Agnes Grey, Anne s’est inspirée de son expérience de gouvernante : elle en connaissait un bout sur le quotidien fastidieux de cette profession réservée aux jeunes filles pauvres, elle le décrit par le menu, tout en réussissant à nous le rendre intéressant. C’est un roman, en effet, plutôt naturaliste. Quant à La Recluse de Wildfell Hall, même si, là aussi, Anne sait de quoi elle parle quand elle décrit les ravages de l’alcool sur un homme, elle est presque visionnaire pour l’époque en imaginant une héroïne capable de quitter un tel époux en emmenant son enfant, de s’émanciper et de vivre de sa peinture.
Charlotte empruntait aussi à sa propre vie, sans jamais écrire à la première personne. Son premier roman, Le Professeur, est plus qu’inspiré par la passion qu’elle éprouva pour Monsieur Heger, son professeur à la pension de Bruxelles, où elle alla étudier avec Emily. Cet amour impossible hante son œuvre, jusqu’à Villette, où il trouve une forme d’accomplissement fictionnel.
Quant à Emily, elle se vouait entièrement à l’Imagination, l’Amie à laquelle elle consacrait même des poèmes.
Je sais qu’il est tentant d’associer Emily Brontë à Emily Dickinson, mais la singularité extrême de chacune fait vite tourner cours la comparaison : elles avaient toutes les deux le goût de la solitude, mais tandis que Dickinson ne quittait pas sa chambre, Brontë courait la lande par tous les temps et accrochait ses jupons à la végétation. Emily de Haworth pouvait identifier un oiseau en examinant une seule de ses plumes ! Emily de Amherst ne se laissait approcher par personne, et si vous aviez chanté pour elle, – à distance-, pour vous remercier, elle vous faisait porter une rose sur un plateau…
Emily et Emily, en revanche, écrivaient toutes deux de la poésie, et si Emily Dickinson est connue pour sa poésie, Emily Brontë l’est beaucoup moins, alors qu’elle est l’auteure d’ une poésie sublime. Chacune des deux semble avoir eu une expérience mystique, mais cela, tout particulièrement, ne peut s’envisager qu’au singulier. Emily B., en revanche, je crois pouvoir le dire, ne se serait jamais adressée à qui que ce soit en qualité de « Maître », Dieu se fût-il caché derrière ce terme. Elle avait son propre Dieu.
Vous avez autoédité votre livre et cela m’intéresse beaucoup, un jour je tenterai moi aussi cette aventure-là, au moins une fois, ce rapport direct au lecteur. Pouvez-vous me dire quelle expérience de l’autoédition est la vôtre ? Regrettez-vous, êtes-vous satisfaite ? Si c’était à refaire…
C’est une excellente question, Olivier. Je dois reconnaître que jamais je n’avais imaginé m’autoéditer. Rien que le mot anglais pour désigner l’édition à compte d’auteur à de quoi faire reculer : Vanity publishing ! Inutile de traduire. Mais, comme les sisters se le sont autorisé pour faire connaître leurs poésies au public, et qu’il leur en a beaucoup coûté au préalable, je me suis appuyée sur elles. Des vraies sisters ! J’ai négocié avec mon surmoi – qui s’est finalement assoupli sur ce point – en me racontant qu’il ne s’agissait pas d’édition à compte d’auteur, mais de publication numérique, alors qu’en réalité, cela revient au même…
Toutefois, si deux maisons d’édition fort honorables n’avaient pas manifesté leur désir d’éditer le livre, pour finalement reculer, je pense que je n’aurais pas franchi le pas. Leur intérêt et leur quasi engagement pour l’une d’elles m’a tenu lieu de Sésame, et je me suis donné l’Imprimatur, ce qui était pour moi d’une audace folle. Ma modestie a été violentée, mais il faut croire que je ne suis pas une authentique violette, car dans le fond je ne regrette pas. Cela m’a permis d’avoir des lecteurs, pas autant que je l’aurais souhaité, mais tout de même quelques-uns. Mon libraire a joué le jeu en faisant bonne place au livre sur son éventaire, et il aurait même organisé une présentation, s’il n’y avait pas eu le confinement. Je pense que n’avoir absolument aucun lecteur aurait été très difficile pour moi, ce en quoi je ne suis pas du tout une Emily Brontë, qui n’écrivait pas pour être lue, tout du moins pour ce qui est de sa poésie… Lorsqu’elle a commencé à écrire pour être lue, c’était pour gagner sa vie, tout comme Charlotte et Anne, et cela donna Les Hauts de Hurlevent. Sinon, elle jouait excellemment du piano, mais pour elle-même ou à la rigueur pour son père malade, et c’est tout.
Alors, si vous me questionnez sur mon expérience de l’autoédition, je vous dirai que j’aurais infiniment préféré ne pas avoir à passer par là, mais que ce n’est finalement pas le pire choix que j’ai fait. Quant à savoir si je recommencerais, je préfère dire que j’essaierais de m’y prendre autrement pour rechercher un éditeur. Et pour reprendre la métaphore deleuzienne du génie comme flèche, je dirai que les sisters ont su faire flèche de tout bois, mais que leurs projectiles ne sont peut-être pas encore retombés. Ils continuent de parcourir l’espace selon une très singulière balistique.
Anna Feissel-Leibovici, Quelle Brontë êtes-vous ?, éd. Librinova, février 2020, 227 p., livre papier 14 € 90, livre numérique 4 € 99