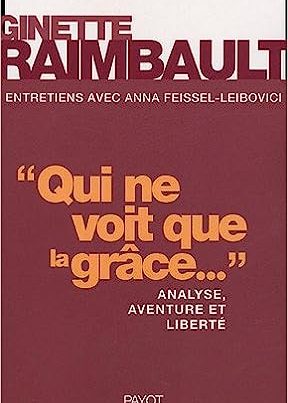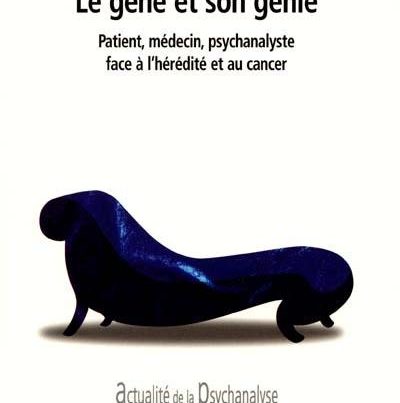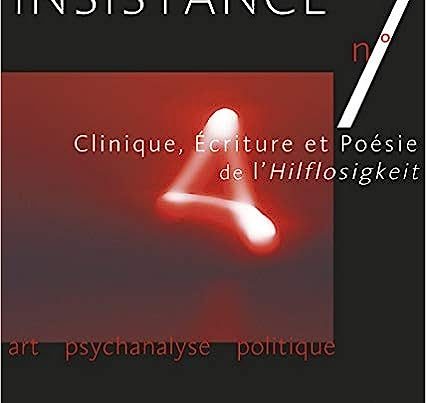Lorsqu’il s’agit d’évoquer le Malaise dans la civilisation , j’ai toujours le sentiment de n’avoir rien à dire. « Toutes les époques », remarque Lacan, se sont crues arrivées au maximum de point d’acuité d’une confrontation avec je ne sais quoi de terminal. »[1] C’est sans doute pour cela qu’au moment où il achève la rédaction du Malaise dans la civilisation, Freud s’excuse d’avoir simplement « redécouvert les vérités les plus banales », et déclare qu’ « aucun ouvrage ne lui a donné », comme celui-ci, « l’impression vive de dire ce que tout le monde sait. »[2] Ce n’est pas une coquetterie.
Recenser les présages de la fin, se lamenter sur le déclin, me paraît être un effet de discours, généré par le « malaise » lui-même. Nous savons que c’est un fait de structure lié à la parole et au signifiant. Comme si nous pouvions vouloir un instant que ça recommence depuis le début, quand bien même ce serait sur un mode meilleur !
Pourtant, c’est le paradoxe, le malaise ne peut se dire que comme un cap sur la catastrophe et sur fond de perte. Dans notre clinique, nous savons que lorsqu’un sujet passe son temps à redouter une catastrophe, c’est qu’elle a déjà eu lieu, « désastre »[3] ou « effondrement »[4]. Il y a plus : Lacan a reconnu dans la détresse, l’Hilflosigkeit freudienne, le rendez-vous que nous aurions à la fin de la cure, « la vraie, précise-t-il, celle qui forme des analystes », avec l’affrontement à la réalité de la condition humaine : il s’agit d’ « atteindre ce fond …où l’homme dans ce rapport à lui-même qui est sa propre mort (…)n’a à attendre d’aide de personne. » Cette expérience du « sans recours » est même pour lui, ce qui marque l’avènement du sujet. C’est de là que nous étions parties, avec Anne Minthe, lors du colloque sur l’Hilflosigkei[5]t, l’année dernière.
Sautons à la conclusion, puisque nous connaissons déjà la fin : il y a là une dimension tragique, et Lacan n’a pas reculé devant le terme, tragique face auquel la psychanalyse ne peut faire aucune « promesse de satisfaction », sauf à rechercher cette satisfaction du côté de la sublimation, ou plutôt du « sublime »[6] Prenant pour pivot de sa conception de la sublimation, l’alliage où le beau dévoile ses affinités avec l’horrible, Lacan se démarque de Freud, et se rapproche de la théorie kantienne du sublime, qui lui permet de prendre en compte cette dimension tragique, aussi bien dans une perspective éthique qu’esthétique.
C’est avec cet arrière-plan que je me suis tournée du côté où point une lueur, vers la question de l’aura : au-delà de ce qu’a été l’élaboration de ce concept pour Walter Benjamin, je me suis demandé, je me demande, ce qui fait que, pour un sujet, elle se pose ou non sur le monde ; en fait, c’est une question qui me retient depuis un certain temps, et qui ne peut pas ne pas renvoyer à la position du poète ; dans cette perspective, l’aura ne me paraît pas pouvoir s’envisager en-dehors de son étroite relation avec l’ « aureur »…C’est la poésie lyrique, la haute poésie, comme on dit la haute mer, qui est le champ par excellence où certains êtres affrontent le réel dans ce qu’il a d’abrupt et de proximité avec l’horreur, exactement comme on parle de faire l’ascension de l’Everest par la face nord. Il y aurait là une fonction du poète tout spécialement, comme il y a une fonction Dieu, une vocation à se confronter à l’impossible, qui suppose le formidable effort d’ébranler la langue, d’attaquer le malheur in situ.
Dans ces conditions, vous devez encore plus vous demander ce qui m’a prise de jeter des paillettes provocantes sur le programme de ce séminaire, comme sur une affiche de spectacle. Il s’agit bien pourtant de ce qui est susceptible de jeter des paillettes sur le monde! Sur la question du « malaise », je n’ai évidemment aucune bonne nouvelle à vous annoncer ; mais cela ne va pas m’empêcher de vous parler des anges ! Impossible de vous parler de Walter Benjamin sans parler de son ange. L’ange est tout de même la figure populaire et religieuse du « recours », depuis des millénaires ; ensuite, s’il est vrai que le discours du malaise s’entretient tout seul et immuablement, nous avons assisté à l’émergence de nouvelles formes de détresse ; je me suis dit que les anges devaient s’en ressentir, que cela devait s’exprimer au travers de leur représentation et j’ai eu envie de suivre ce fil.
De l’ange à l’aura, il n’y a pas tant d’écart qu’il y paraît, parce que l’existence des anges participe du même phénomène que celui de l’aura, celui de l’ « apparition ». Souffle – c’est le premier sens du mot-, brise ou halo, si l’aura se pose sur l’objet, si elle l’entoure, elle en intensifie le perçu pour le regard, en même temps qu’elle échappe, « unique apparition d’un lointain, si proche soit-il », écrit Benjamin. Elle ouvre sur l’inapprochable et l’inappropriable. Cette dimension de « l’apparaître » me paraît pouvoir se penser comme l’un des régimes du réel, en ces moments très particuliers où la Chose se révèle derrière l’objet d’amour, ainsi que Lacan l’a mis en évidence avec le joy des troubadours, ou bien s’appréhende comme sous-jacente au spectacle du monde ; alors le réel fulgure, devient éblouissant. « Ce qui se produit à partir de la Chose », dit Lacan, -mais c’est déjà dans l’Esquisse-, « se produit sur le mode de l’apparition, Erscheinung, il y a dans le terme l’idée d’une vision pas tout à fait dépourvue d’hallucination. »[7] Cet éclat éblouissant que certains poètes vont préférer à la possession de tout objet d’amour, marque aussi, selon Lacan, le rapport de l’homme à sa propre mort.
Aborder la question de l’aura ainsi, c’est dire tout de suite qu’elle m’intéresse moins dans sa dimension historique que dans ce qu’elle indique, chez Benjamin, de son rapport à la Chose et aux choses. Il n’est d’ailleurs pas du tout assuré que l’aura ait déserté l’art ; Adorno le dit clairement à Benjamin, dans leur correspondance, et la position de Benjamin lui-même à ce sujet est très ambiguë. C’est cette ambiguité, cette ambivalence même, qui m’intéresse et me paraît la plus neuve.
Benjamin n’écrivait pas de poésie ; il était philosophe, et, comme le dit Gershom Scholem, le « pur exemple du métaphysicien »[8]. Mais il regardait ce que les métaphysiciens ne regardent pas d’habitude, des objets surtout, dont il parvenait à lire la vie cachée, et qui lui rendaient bien son intérêt en lui permettant de les pénétrer jusqu’à des strates « sur lesquelles brille une lumière d’un étrange éclat. »[9] Je rapprocherai l’aura de ce que fut l’Erlebnis pour Rilke, à la même époque : on peut dire avec Martine Broda que Benjamin fut « ravagé lui aussi par le passage d’un Ange dont le sillage éclatant serait la trace du perdu. »[10]Cet Ange lui apparut, entre autres formes, dans la représentation d’une aquarelle peinte par Paul Klee, intitulée Angelus Novus, et dont il fit l’acquisition en 1921. Il tenait infiniment à ce tableau dont il ne se séparait qu’en cas de force majeure. Ce fut le cas pour la dernière fois, en 1943, lorsque le facisme le conduisit dans une impasse d’une telle absurdité qu’il céda à sa mélancolie et se donna la mort.
Il venait d’être rejeté par une femme et il venait d’abandonner son ange.
Dans ce destin, la détresse s’est ajointée à la figure de l’ange-gardien, d’un bout à l’autre de la vie, puisque dans un texte ésotérique, intitulé « Agésilaus Santander »[11], Benjamin présente tout d’abord son Ange dans la perspective traditionnelle d’un protecteur que ses parents ont voulu lui donner à sa naissance, avec cette singularité que la protection à donner est associée, dans le désir des parents, à l’idée que leur fils pourrait devenir écrivain. Les écrivains, il semblerait donc qu’il leur faille un surcroît de protection, surtout lorsqu’ils sont juifs. Dans leur grande clairvoyance, les parents de Benjamin lui auraient donc donné deux autres noms,secrets, comme il est d’usage dans les familles juives religieuses, noms qui ne se sont révélés qu’au moment de la Bar-Mitzva. Mais comme l’a dit Rilke : « Tout Ange est terrible », et dès que Benjamin noua une relation en son nom avec son Ange, celle-ci excéda naturellement les vœux des parents : profitant de ce que l’enfant était né « sous le signe de Saturne », l’Ange lui « fit payer », écrit-il, de l’avoir retenu et empêché de « chanter » suffisamment à la gloire de Dieu, avant de retourner au néant, conformément à sa vocation d’ange pour la Kaballe.
Je situerais ce « chant » dont Benjamin serait resté en dette ainsi que le risque particulier encouru par l’écrivain et plus encore le poète, très précisément dans la relation qu’ils entretiennent à la Chose, s’il est vrai qu’elle s’exprime par la création de formes imaginaires qui sont spécifiées historiquement et socialement.
Selon Benjamin, l’aura inscrit clairement sa disparition dans la modernité : son déclin serait le prix à payer pour accéder à la sensation de la « modernité ». « Modernité » est un terme qu’il emprunte à Baudelaire et qui désigne, le retour du même, sous couvert de la mode, répétition dénuée de « vraie solution libératrice ». Mais s’il trouve Baudelaire « héroïque »[12], c’est pour avoir la conscience de cette illusion fantasmagorique, et de la fausse sécurité – die Geborgenheit, l’abri, terme qui revient souvent chez lui – offerte par les « passages » parisiens, sans pour autant éviter le « choc » traumatique de la rencontre avec la foule. C’est pour cette raison qu’il le reconnaît comme le dernier grand poète lyrique d’Europe. Comme Malte, Baudelaire a rencontré l’horreur de la grande ville, comme Rilke qui y voyait la condition de son œuvre, il l’a dépassée ; c’est en pensant au poème de Baudelaire, « La Charogne » que Rilke écrivait : « Le Beau est le commencement du Terrible » Et si Benjamin admire tant chez Baudelaire, cette force d’échapper à l’emprise –der Bann—, à l’envoûtement de cette civilisation de richesses marchandes, c’est sans doute parce que lui-même a du mal à se dégager de la fascination qu’elles exerçaient sur lui . C’est la source principale de son ambiguïté à l’égard de l’aura. Ce n’est pas pour rien que Benjamin fut un « écrivain-collectionneur », et collectionneur dès l’enfance.
Dans cette oscillation entre ce qu’un critique a pu appeler la « barbarie positive » d’un Benjamin suggérant à l’artiste d’assumer jusqu’au bout, jusqu’à la déshumanisation, les conséquences de la modernité esthétique, et la nostalgie que les choses se présentent à nous sans la distance protectrice de l’aura qui les sacralisait, j’ai fini par m’intéresser à ce mouvement lui-même. Certains textes autobiographiques rédigés par l’adulte, dans le climat du facisme, en situent l’émergence dès l’enfance. Tout indique, dans Enfance berlinoise, qu’il a connu des moments de communion extatique avec la nature, mais chaque texte du recueil transcrit une expérience ambivalente où se mêlent espérance et déception. Un texte comme « La chasse aux papillons »[13] est un bon exemple de ce qui se passe au cours de ces «épiphanies profanes » : l’enfant est tellement amené à se « dissoudre en air et en lumière » , par mimesis avec les papillons qui sont sa proie, qu’il court le risque de basculer dans l’invisibilité, d’être aspiré. Survient alors une réaction de rupture de l’instant auratique, où la violence du chasseur reprend ses droits. Dans la fusion cosmique avec le monde naturel, le danger qui guette l’enfant, est l’autre versant, kafkaïen, de la métamorphose : se retrouver figé en chose, s’identifier si complètement à l’animal, qu’on en perde son identité.[14] La question de la « chosification », de la réification, est en effet centrale dans l’œuvre de Walter Benjamin, qu’il s’agisse de la relation à la photographie, de Baudelaire, ou des réflexions plus générales sur le XIXème siècle, comme le siècle des marchandises. Tout semble menacé de réification, même l’aura : l’image finit par s’y mortifier en souvenir, fétiche mental, ensuite infiniment reproductible. Face à ce péril, une solution, un seul recours, le geste brusque qui arrache l’être vivant (l’enfant, mais aussi l’humanité) à cette soumission aux forces mythiques et obscures de la nature.
Pour l’enfant, la libération de l’identification à l’animal passe par la saisie de l’objet et son meurtre. L’aura réclame sa rupture ; c’est là un point éminemment singulier chez Benjamin, sur lequel il se différencie de Proust et de Rilke, nous allons le voir. J’aurais presque envie de parler d’une « résistance » au moment auratique.
Benjamin peut en parler au plus proche de l’expérience proustienne : « Suivre du regard, un après-midi d’été, la ligne d’une chaîne de montagnes à l’horizon ou une branche qui jette son ombre sur lui, c’est, pour l’homme qui repose, respirer l’aura de ces montagnes ou de cette branche. »[15] Il y a pourtant une différence essentielle : il est vrai que chez Proust, le passé est caché hors du domaine de l’intelligence et de sa portée, en quelque objet matériel que nous ne soupçonnons pas ; que cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas. Mais, ces instants éternels, ces extases, Proust n’en a pas eu tant que cela dans sa vie, et pour cause ! Beckett en recense onze, onze « fétiches » ou « visitations »[16], sans compter quelques tentatives avortées. Or, c’est bien sur cette dizaine d’expériences auratiques, sur leur rareté – sorte de déclin inversé-, que Proust va bâtir sa Recherche, comme Rilke avec ses Erlebnis ou Joyce avec ses épiphanies. Chez eux, elles figurent telles quelles dans l’œuvre, et qu ‘elles soient dotées ou dénuées de sens, lumineuses ou triviales, ils les reconnaissent comme le noyau de cette œuvre, der Kern. Donc, la Recherche est dite du Temps perdu, mais des retrouvailles ont lieu : dans le suspens d’un temps d’arrêt, une révélation jaillit de la trivialité, fondant en outre la vocation de l’écrivain, qui se voue à en déchiffrer l’énigme.[17] Ce n’est pas vraiment le cas chez Benjamin : l’enfant croyait entrevoir dans les objets qu’il collectionnait, une énigme que l’adulte a laissée sans solution. Je dirais que Benjamin n’est pas parvenu à « trouver son bonheur » dans l’insondable banalité d’une tasse. Il me semble que chez lui, l’aura reste liée à l’objet, à sa saisie et court le risque de se perdre avec lui, là où la « Chose majuscule » se diffracte au dehors en choses et « se répand sur l’univers de la matérialité »[18]. Le fait est que l’évocation de « Berlin », celui de son enfance, est un monde enfoui de lieux et de choses – eine Dingwelt-.
L’ambiguïté de Benjamin pourrait donc se résumer ainsi : il faut, dans une lucidité impitoyable se dépouiller des faux enchantements qui ont pu faire croire au bonheur, – de l’aura, donc-, mais répudier l’aura, ce serait répudier toute promesse de bonheur. Pour lui, elle a toutefois trouvé refuge et lieu d’élection dans les noms, puisqu’ elle n’a pas d’autre lieu que le langage. Dans les noms, les noms adamiques ou bien les noms de lieux, comme chez Proust, par exemple, se trouve préservée la place d’un art auratique, puisque le poète est celui qui sait, selon les termes de Benjamin, « frapper (la nature) d’enchantement à chaque nouvel appel. » Dans un texte intitulé « Amour platonique »[19], celui-ci est défini comme l’amour d’un nom, et Benjamin parle du monde et de l’œuvre surgis de ce nom comme de « l’aura autour du nom de Béatrice ». La poésie lyrique amoureuse est effectivement le lieu privilégié où peut survivre l’aura : dans cette tradition, elle a nimbé plusieurs surnoms de dames souvent illustres : pour Pétrarque, Madonna Laura, et pour Nerval, Aurélia. Pour Bataille et Leiris, le surnom fut Laure, et pour Leiris et Jouve, Aurora[20].
L’ambivalence de Benjamin à l’égard du déclin de l’aura a comme corollaire la conscience aigüe du double visage de la modernité –et peut-être de toute modernité. Cela fait de Benjamin un penseur de la « crise » au vrai sens du terme : *crisis : le choix[21]. Dans une sorte de stratégie ascétique et de pari , il choisit toujours la modernité, même si cela va jusqu’à accepter pleinement le sacrifice de la culture, et la fin de la notion traditionnelle d’œuvre et d’auteur.
Maintenant que les dieux sont morts, c’est la tâche qui échoit à l’écrivain moderne que de transmettre la perte même.
Le pari de Benjamin qui consiste à attendre la plénitude, et non des demi- mesures progressives ni du vide consolant, mais du vide assumé, le rapproche d’un bon nombre d’écrivains et de poètes de la modernité ; l’adulte qui se penche sur son enfance berlinoise « a appris », selon ses propres termes, « à se passer de la sécurité (Die Geborgenheit)- maternelle, morale, psychologique-, qui caractérise cette enfance. »
Le « frisson » dont se paye l’accès à la sensation de cette modernité, n’est pas sans évoquer « le risque voulu » par Rilke, et sur lequel il fonde sa position de poète, dans une sorte de retournement, où , comme il le dit, « Ce qui nous abrite à la fin, c’est l’insécurité de notre être »[22].
Pourtant, me semble-t-il, Benjamin n’a pas pu prendre totalement appui sur ce retournement même, d’où l’aura s’ étend au monde, au-delà de tout objet. Je ne suis pas sûre, et c’est ma question, qu’il ait fait ce type de rencontre avec le réel, où l’appel reçu de l’Autre est éprouvé comme exigence, voire comme élection. Est-ce parce qu’il n’était pas poète ? Est-ce pour cela qu’il n’était pas poète ? C’est tout de même la poésie qui a le plus d’affinités avec ce type de retournement : le vers –versus- est en lui-même un retournement. Lorsque Rilke parle de « risquer plus, d’un souffle, plus »[23], il dit la position impossible du poète : qu’est-ce que ce souffle énigmatique ? Il nous ramène à l’aura : le vers se spécifie de l’enjambement, et la poésie se fonde sur un « geste ambigü, tourné à la fois en arrière et en avant ». Ce « suspens », qu’Agamben qualifie de « sublime hésitation » entre le son et le sens », implique également que le poème ne finisse jamais, que le souffle du poète en repousse toujours la fin, pour que n’ait pas lieu la coïncidence du son et du sens[24]. Le poète est toujours soumis à la question, et nous ne serons jamais assez poètes.
Pour me faire mieux comprendre, il faudrait que je me livre à un exercice étrange, celui de comparer des Anges. Les Anges de Rilke différent de ceux de Benjamin : pour pouvoir opérer le retournement de la mort dans la vie, de la négation en pure affirmation, ils réclament un acte d’abandon. Les Anges de Rilke ne sont pas sans susciter l’effroi, mais ils aident à surmonter la peur. En faisant face, toujours face (c’est la définition du destin, pour Rilke), ils aident à l’assomption du Terrible, dont Rilke, dès ses commencements avait fait le but de l’art. Je dirais que les Anges de Benjamin sont orientés différemment ; celui de l’Histoire notamment, l’Angelus Novus, est tourné vers le passé : immobilisé dans cette direction, sous l’effet d’ « une tempête qui est ce que nous appelons le progrès », il ne peut pas regarder vers l’avenir et assiste, « les yeux écarquillés » à la « chaîne des événements », où « il ne voit qu’une seule et unique catastrophe. »[25]
Là où les Anges de Rilke sont les passeurs entre le passé et le présent, entre les vivants et les morts, ceux de Benjamin semblent assister à l’engloutissement du passé.
Je répète à dessein : « ils assistent ». C’est un terme qui mérite d’être déployé dans son équivocité. De nombreux textes de Benjamin, souvent des textes brefs et à dimension autobiographique, font référence à « l’assistance technique » et à ce qu’il appelle des « assistants ». Il paraît clair qu’il y a là une référence à Kafka : on rencontre dans les romans de Kafka des créatures étranges qui se définissent comme des « assistants », Gehilfen, très exactement. Mais ils ne semblent pourtant pas pouvoir apporter quelque assistance que ce soit. Benjamin a écrit de très belles pages sur eux, soulignant à quel point ils ne sont bons à rien, ne disposent d’aucun « appareil », et ne se livrent qu’à des pitreries. Peut-être leur assistance consiste-t-elle en ce qu’ils n’offrent pas le moindre secours. Ils n’apparaissent pas sous la forme d’anges identifiables, sauf une fois où ils sont figurants dans un théâtre, ou encore impressario d’un trapéziste.
Le plus souvent, les « assistants » sont des créatures inachevées, des « êtres au stade nébuleux »[26], dit Benjamin . Mais, pour eux et leurs pareils, pour les inachevés et les malhabiles, il y a encore de l’espoir…C’est ce que Kafka dit un jour à Janouch, en éclatant de rire : « il existe un espoir infini, simplement pas pour nous ! » C’est sur une pensée voisine que Benjamin a conclu son essai sur Les Affinités électives : « Pour les désespérés seulement nous fut donné l’espoir. »[27] L’espérance, chez lui, ne peut resurgir que lorsque l’ombre de la catastrophe imminente assombrit tous les espoirs. C’est un renversement, mais plus proche d’un nihilisme messianique que de l’amor fati. Il y a dans l’amor fati quelque chose de « la splendeur et de l’éclat qui sèche le malheur »,[28] pour reprendre la belle formulation de Deleuze. Je dirais : quelque chose d’une aura qui se pose sur le malheur lui-même. Mais pour Benjamin, c’est « le désespoir et « l’irrémédiable détresse du solitaire » qui lui paraissent être la rançon de la sensibilité au choc de la modernité et le prix payé par Baudelaire. Je dirais que le malheur de la chose marchande l’a touché et même entaché.
Pour terminer, je voudrais évoquer un autre tête à tête avec Berlin, non plus celui d’un enfant à l’orée du XXème siècle, mais celui de Wim Wenders, en 1987. Curieusement, dans Les Ailes du désir, c’est aussi à des anges et à une trapéziste qu’il a confié le soin de répondre à ses questions : qu’est-ce que Berlin, en 1987 ? Comment peut-on voir cette ville ? Peut-on souhaiter y naître et y vivre ? Vous connaissez la réponse : l’un des deux anges, refusera de s’incarner, exprimant par là la profonde ambivalence des sujets par rapport à ce qui les humanise, ce qui est l’idée principale de Freud dans le Malaise. L’autre ange choisira de partager la grande Chute des humains et ce désir lui viendra de l’amour pour une femme ; il se trouve qu’elle est trapéziste dans un cirque et qu’elle a beaucoup de mal à gagner l’aisance aérienne : elle se trouve un peu gauche et elle en souffre au point qu’au cours d’une répétition, déprimée par sa pesanteur, elle invective les accessoires décevants qui lui tiennent lieu d’ailes, en les traitant de « truc » et de « plumes de poulet » ! Mais pourquoi une trapéziste ? « L’art que ces acrobates exercent dans les airs sous le dôme des grands music-halls est, on le sait, écrit Kafka, l’un des plus difficiles auquel l’homme puisse s’élever. »[29] Et c’’est bien dans ce dispositif scénique du cirque, où son héroïne bataille avec son « truc en plumes », que Wenders place son espoir.
Qu’est-ce que cette scène de théâtre ou de cirque, sur laquelle pourrait avoir lieu un acte fondateur et mystérieusement structurant ? Je pense aussi à l’étrange théâtre d’Oklaoma, dans l’Amérique[30], de Kafka, : sur quel critère les candidats sont-ils retenus pour être engagés dans ce théâtre, nul ne peut le découvrir ; le grand théâtre d’Oklaoma engage n’importe qui.
Il faut admettre que la scène représente un ultime refuge, sur laquelle les êtres qui peuplent ce théâtre, ne font pas autre chose que témoigner de ce qu’ils sont, par-delà tout ce qu’ils ont pu faire ou seront. Dans son essai sur Kafka, Benjamin y voit un acte théâtral rédempteur. Cela évoque le dispositif allégorique de « l’ange de l’histoire », mais comme pris à l’envers : l’ange serait devenu homme – tous les hommes, absolument tous – et, devenant humain, il en vient paradoxalement à trouver des parades au vent destructeur de l’histoire qui le perd. Il n’est plus, ici, une figure d’exception, mais un exemplaire anonyme parmi tant d’autres, qui rend compte de ce qui arrive à tous ceux qui participent de l’humanité. La scène naturelle du théâtre d’Oklahoma est un « théâtre de gestes », dit Benjamin : elle rassemble des êtres qui sont fidèles à leur geste, vivants et capables de le rendre incessamment présent. Ce qui veut dire : sans jamais en oublier le moindre geste, le moindre mot, le moindre souffle[31]. S’ils y parviennent (mais comment le savoir, au fond ?) , sur la scène naturelle d’Oklahoma, « ses comédiens seront sauvés ».
.
[1] J. Lacan, L’Ethique de la psychanalyse, Seuil, 1986, p. 125. [2] S. Freud, Malaise dans la civilisation, Puf, p. 71. [3] M. Blanchot, L’écriture du désatre. Gallimard, 1980. [4] D.W. Winicott, « La crainte de l’effondrement », Figures du vide, NRP, Gallimard, 1975, p, 35. [5] Colloque « Clinique,Ecriture et Poésie de l’Hilflosigkeit », Insistance,Paris, avril 2005. Actes à paraître. [6] J. Lacan, ibidem, op.cité, p. 346. [7] J. Lacan, ibidem, op. cité, p. 75. [8] G. Scholem, Benjamin et son ange, Rivages, 1995, p. 33. [9] G. Scholem, ibidem, p. 35. [10] Martine Broda, « Lyrisme et aura », L’Amour du nom, Corti, 1997, p. 241. [11] W. Benjamin, « Agesilaus Santander », Ecrits autobiographiques, Bourgois, 2000, pp. 333-338. [12] W. Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », Œuvres III, Gallimard, pp. 329-390. [13] W. Benjamin, Enfance berlinoise, M. Nadeau, 2000, pp. 41-43. [14] Je renvoie, ici, à la belle analyse que Jean Lacoste fait de ce texte, dans son article « L’enfance de l’art », Walter Benjamin, Critique philosophique de l’art, Puf, 2005, pp.23-46.
[15] W. Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Œuvres III, p. 278.
[16] S. Beckett, Proust, Minuit, 1990. [17] A ce sujet, cf. Catherine Millot, La Vocation de l’écrivain, Gallimard, 1991. [18] G. Pommier, Qu’est-ce que le réel ?, Erès, 2004, p. 28. [19] W. Benjamin, « Amour platonique », Œuvres II, p. 340. [20] Cf. Martine Broda, op. cité, p. 244. [21] Cf. Jean Lacoste, L’aura et la rupture,Walter Benjamin, Maurice Nadeau, 2003. [22] Rilke, Œuvres, II, p. 436. [23] Rilke, ibidem. [24] G. Agamben, La Fin du poème, Circé, 2002, p. 136. [25] W. Benjamin, « Poésie et Révolution », pp. 281-282. [26] W. Benjamin, « Franz Kafka », Œuvres II, pp. 410-453. [27] W. Benjamin, « Les Affinités électives de Gœthe », Œuvres I, pp. 410-453. [28] G. Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1969, p. 175. [29] F. Kafka, « Première souffrance », Pléiade, II. [30] F. Kafka, L’Amérique, ch. VIII, « Le théâtre de la nature d’Oklaoma », Gallimard, 1965. [31] Cf. l’article de Bruno Tackels, »Les Kafkas de Benjamin », in Walter Benjamin, Critique philosophique de l’art, op. cité, pp. 71-89